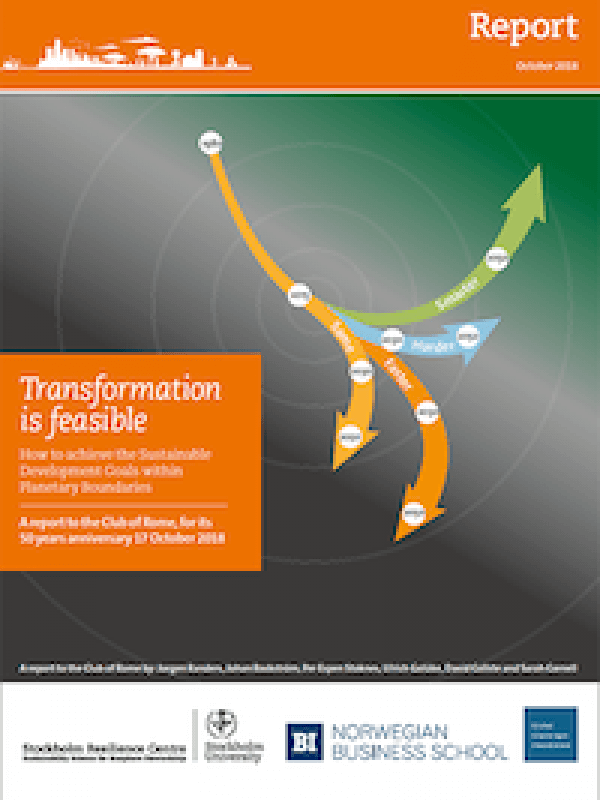Les écologistes anti-impact veulent votre mort ; ils se contenteront de vous faire culpabiliser d’exister, de produire et de consommer, et de vous soumettre à n’importe quel degré de planification centralisée et de restriction de vos libertés pour « sauver la planète » de vous.
Joshua Mawhorter
"La seconde variation s'est manifestée par le tournant à gauche qu'a pris la préoccupation croissante pour les questions environnementales. Alors que le mouvement marxiste se fragmentait et se transformait en de nouvelles formes, les intellectuels et militants de gauche ont commencé à chercher de nouvelles façons de s'attaquer au capitalisme. Les questions environnementales, au même titre que les questions relatives aux femmes et aux minorités, sont apparues comme une nouvelle arme dans l'arsenal contre le capitalisme. La philosophie environnementale traditionnelle n'était pas, par principe, en conflit avec le capitalisme. Elle soutenait qu'un environnement propre, durable et agréable était bénéfique car vivre dans un tel environnement rendait la vie humaine plus saine, plus prospère et plus plaisante. Les êtres humains, agissant à leur avantage, modifient leur environnement pour le rendre plus productif, plus propre et plus attrayant… Cependant, le nouvel élan de la pensée environnementale a appliqué les concepts marxistes d'exploitation et d'aliénation aux questions environnementales. En tant que partie dominante, l'être humain exploite nécessairement de manière nuisible les parties dominantes : les autres espèces et l'environnement non organique lui-même. Par conséquent, le développement de la société capitaliste engendre une forme d'aliénation biologique : les humains s'aliènent de l'environnement en le dégradant et en le rendant invivable, tandis que les espèces non humaines sont aliénées par leur extinction. Selon cette analyse, le conflit entre production économique et santé environnementale n'est donc pas seulement un conflit à court terme ; il est fondamental et inéluctable. La production de richesses est en elle-même en conflit mortel avec la santé environnementale. Et le capitalisme, si performant dans la production de richesses, est par conséquent nécessairement le principal ennemi de l'environnement. La richesse n'était donc plus une vertu. Vivre simplement, en évitant autant que possible de produire et de consommer, était le nouvel idéal. L'impulsion de cette nouvelle stratégie, parfaitement saisie dans l'ouvrage de Rudolf Bahro, « Du rouge au vert », s'est intégrée à la nouvelle priorité accordée à l'égalité plutôt qu'aux besoins. Dans le marxisme, la maîtrise technologique de la nature par l'humanité était une condition préalable au socialisme. Le marxisme était un humanisme en ce sens qu'il plaçait les valeurs humaines au cœur de son système de valeurs et postulait que l'environnement était à la disposition des êtres humains pour leurs propres besoins. Cependant, les critiques égalitaristes ont commencé à argumenter avec plus de vigueur que, de même que la primauté des intérêts masculins avait conduit à l'asservissement des femmes, et celle des intérêts blancs à l'asservissement de toutes les autres races, la primauté des intérêts humains avait conduit à l'asservissement des autres espèces et de l'environnement dans son ensemble. La solution proposée était alors l'égalité morale radicale de toutes les espèces. Il fallait reconnaître que non seulement la productivité et la richesse étaient mauvaises, mais aussi que toutes les espèces, des bactéries aux cloportes, des oryctéropes aux humains, étaient égales en valeur morale. L'« écologie profonde », nom donné à l'égalitarisme radical appliqué à la philosophie environnementale, rejetait ainsi les éléments humanistes du marxisme et leur substituait le système de valeurs anti-humaniste de Heidegger."
"C’est la conséquence logique de l’adoption du principe de non-impact humain comme critère de valeur : le meilleur moyen d’y parvenir est de ne rien faire du tout, de ne pas exister. Bien sûr, rares sont ceux qui adoptent ce principe de manière constante, et même ces personnes ne dépeuplent pas la planète par elles-mêmes. Mais dans la mesure où nous érigeons le non-impact humain en critère de valeur, nous allons à l’encontre de ce que notre survie exige."
"Chaque être humain produirait 1,69 tonne de dioxyde de carbone par an, soit l'équivalent de 14,5 kilomètres par jour en voiture américaine moyenne. Lorsque la population atteindra 8,5 milliards d'habitants, vers 2025, ce chiffre tomberait à 9,5 kilomètres par jour. En covoiturant, il vous resterait environ 0,3 kilomètre de CO2 dans votre ration quotidienne, de quoi alimenter un réfrigérateur à haute efficacité énergétique. Oubliez votre ordinateur, votre télévision, votre chaîne hi-fi, votre cuisinière, votre lave-vaisselle, votre chauffe-eau, votre micro-ondes, votre pompe à eau, votre horloge. Oubliez vos ampoules, qu'elles soient fluocompactes ou non."
"Aujourd'hui, à la chapelle, nous avons fait une confession aux plantes. Ensemble, nous avons confié en prière nos peines, nos joies, nos regrets, nos espoirs, notre culpabilité et notre chagrin à ces êtres qui nous nourrissent mais dont nous oublions trop souvent d'honorer les bienfaits. Et vous, que confessez-vous aux plantes qui vous entourent ?"
"Cela rend la situation d'autant plus tragique pour ceux d'entre nous qui chérissent la nature sauvage pour elle-même, et non pour ce qu'elle apporte à l'humanité. Personnellement, je ne peux souhaiter ni à mes enfants ni au reste du vivant une planète apprivoisée, une planète gérée par l'homme, qu'elle soit monstrueuse ou – aussi improbable que cela puisse paraître – bienveillante. McKibben est biocentriste, et je le suis aussi. L'utilité d'une espèce, d'une rivière ou d'un écosystème pour l'humanité ne nous intéresse pas. Ils ont une valeur intrinsèque, plus grande à mes yeux qu'un autre corps humain, ou qu'un milliard d'entre eux. Le bonheur humain, et certainement la fécondité humaine, ne sont pas aussi importants qu'une planète sauvage et saine. Je connais des sociologues qui me rappellent que l'être humain fait partie intégrante de la nature, mais c'est faux. À un moment donné – il y a environ un milliard d'années, peut-être la moitié – nous avons rompu le contrat et sommes devenus un cancer. Nous sommes devenus un fléau pour nous-mêmes et pour la Terre. Il est extrêmement improbable que les pays développés mettent fin à leur consommation effrénée d'énergies fossiles, et les pays en développement à leur exploitation suicidaire des paysages. En attendant que l'Homo sapiens se décide à renouer avec la nature, certains d'entre nous ne peuvent qu'espérer l'apparition du virus adéquat."
La fin du GIEC : révélation d’une escroquerie climatique globale