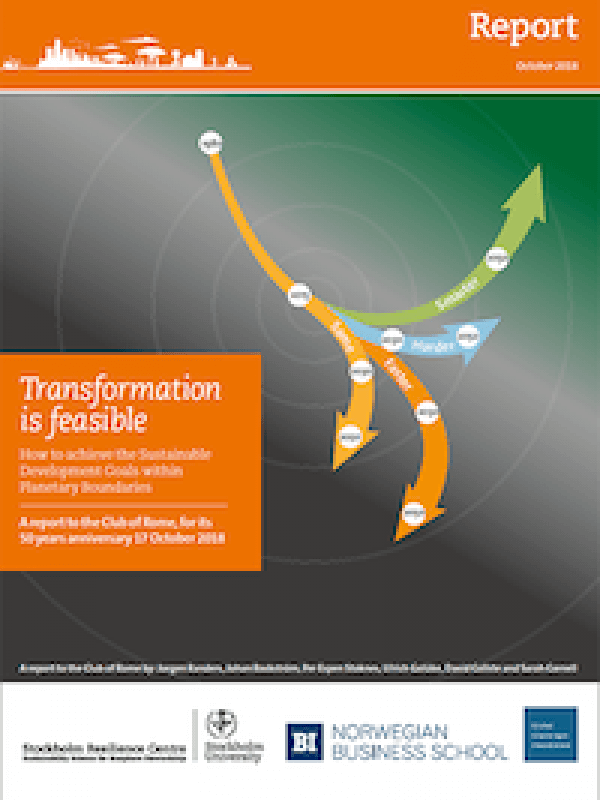Français, soyons excellents ou nous disparaitrons !
Même le plus fieffé des optimistes ne peut nier que
l’Europe, entourée de prédateurs, n’est pas à la hauteur des enjeux : on
y travaille beaucoup moins qu’ailleurs, les retraités y sont mieux
traités que les actifs, peu d’entreprises nouvelles y surgissent ; les
innovateurs la quittent ; les entreprises étrangères y investissent très
peu dans les domaines de pointe ; on y fait de moins en moins
d’enfants ; on y forme beaucoup moins d’ingénieurs que sur tous les
autres continents. Et c’est particulièrement vrai en France, qui
ressemble maintenant à un camion fou lancé dans une grande descente,
avec quatre ou cinq chauffeurs sans permis se disputant le volant.

Sans aligner trop de chiffres, juste quelques-uns : quand la Chine
consacre 9% de son PIB à la recherche et l’innovation, et l’Allemagne et
le Japon plus de 3,5%, la France est, pour la première fois depuis
1981, en dessous de 2%. Quand le Japon et l’Allemagne, pays
vieillissants s’il en est, consacrent 9, 5% de leur PIB au financement
des retraites, la France y consacre 15% et bien plus si on tient compte
de toutes les dépenses associées à l’âge. En France, on part à la
retraite trois ans avant les autres pays européens qui sont d’ailleurs
en train d’augmenter encore l’âge de départ ; et près de la moitié de la
dette publique française est liée à la mauvaise gestion des retraites, à
un moment où le système scolaire est aux abois, les hôpitaux au bord de
la faillite et où la natalité s’effondre, rendant impossible de
financer durablement les retraites à leurs niveaux actuels. Quand
l’Allemagne fait le plein de ses écoles d’ingénieurs, la France a le
plus grand mal à trouver des candidats, et surtout des candidates, pour
remplir les siennes. Quand les autres pays ont un gouvernement, avec un
budget, des priorités claires et un horizon suffisamment éclairci pour
que les entrepreneurs aient un peu envie d’investir, il faudrait être
fou pour investir en France, pays qui n’a pas de budget, dont le
gouvernement abandonne ses rares réformes courageuses pour durer
quelques jours de plus, où tous les partis se contentent de promesses
démagogiques, de concessions insensées à tous les groupes d’intérêt,
où on en est à désigner des boucs émissaires , où les palinodies
d’un parlement balkanisé participent d’un suicide collectif. Et où il
n’y a plus personne pour indiquer un cap et s’y tenir.
Pas étonnant alors que la démocratie, et les élites qui ont conduit à
ce désastre, soient remises en cause ; et que beaucoup en viennent à
penser qu’un gouvernement autoritaire, ou au moins illibéral, débarrassé
des technocrates, ne ferait pas pire et au moins mettrait de
l’ordre. Pas étonnant non-plus que les partis qui prônent cela soient à
la fois xénophobes, antieuropéens, nationalistes et populistes.
L’avenir est alors tout tracé : une victoire à venir du
Rassemblement National, qui assumera la volonté de faire de la France un
pays isolé, moyen, sans volonté d’excellence et de puissance, un pays
qui se flattera d’être gouverné par des gens non diplômés parce que les
super diplômés auront montré leur incompétence. Car le programme de ce
parti se résume, quoique disent ceux qui le dirigent, à : « Plus
d’impôt. Moins d’étrangers. Moins de travailleurs. Moins d’Europe.
Moins d’excellence ». Sa mise en œuvre, applaudie par les retraités et
par tous les nostalgiques d’une France imaginaire, ne fera qu’aggraver
la crise financière du pays. Les élites en partiront, les investisseurs
et les chercheurs étrangers en feront autant. La dette publique
augmentera. Jusqu’à ce que les marchés, ou le FMI, ou Bruxelles,
viennent rappeler le réel, comme ils l’ont fait à d’autres pays, qui y
ont laissé la moitié de leur niveau de vie.
Et c’est ce qui attend la France dans moins de dix-huit mois. Par la
faute de ceux qui n’ont pas eu le courage, depuis tant d’années,
d’entreprendre les réformes nécessaires, en préférant jouir du pouvoir
plutôt que de s’en servir pour porter plus haut le pays. Et de tous ceux
qui, aujourd’hui, lâchement, rallient les puissants à venir, pour ne
pas perdre leurs privilèges.
On a encore la possibilité de réagir. De ne pas se résigner. De ne
pas prendre acte d’une étrange défaite. De mettre en avant une jeunesse
magnifique, qui ne demande qu’à se mettre au travail et à s’ouvrir au
monde, ; qui enrage de voir la place laissée aux rentiers de toutes
nature, retraités ou employés surnuméraires d’administrations
pléthoriques, alors qu’on manque tant d’ingénieurs, de professeurs,
d’infirmières, d’ouvriers qualifiés, de médecins, de policiers, de
paysans, et de tant d’autres métiers vitaux pour l’avenir du pays et en
particulier pour affronter les problèmes environnementaux de demain.
Cela suppose des réformes courageuses. Par exemple, les retraités
doivent accepter de voir leur part du revenu national baisser, et vivre
en dépensant leur patrimoine, lorsqu’ils en ont un, et pas des impôts
payés par ceux qui travaillent. Et il faut bien accueillir et très bien
intégrer un grand nombre d’étrangers, soigneusement choisis, pour ne pas
disparaître.
Il ne reste pas beaucoup de temps pour réagir. Pour donner le pouvoir
aux plus jeunes. La réponse n’est sûrement pas dans les partis actuels,
qui ne proposent rien et ne pensent qu’à continuer à profiter des
prébendes publiques. Elle est dans un sursaut des entreprises, des
associations, des syndicats, des chercheurs, des jeunes, des gens de
bonne volonté, qui croient encore que la France et l’Europe doivent
viser l’excellence et rester, pour cela, ouvertes au monde. C’est parmi
eux que se trouvent les sources d’un éveil. En espérant qu’il ne tarde
pas trop.
http://www.attali.com/societe/francais-soyons-excellents-ou-nous-disparaitrons/
Sommes-nous prêts à payer le prix de la souveraineté ?
Depuis quelques mois, chacun a compris l’importance de ne
pas dépendre d’une source unique de produits agricoles, d’énergie, de
matières premières, de composants, d’armement. Et de bien d’autres
choses. Aux États-Unis, en Europe, en Chine, a commencé la chasse aux
dépendances. Personne, nulle part en Occident au moins, ne veut plus se
trouver en situation d’avoir besoin d’attendre l’accord des Chinois pour
avoir les aimants nécessaires à son industrie automobile. Aucun
industriel chinois ne veut plus dépendre des microprocesseurs graphiques
et des plateformes de calcul fabriqués par Nvidia. Aucune entreprise
américaine ne veut plus dépendre des Chinois pour les terres rares et
les matériaux critiques. Les Européens réalisent la sujétion dans
lesquels ils se sont placés en n’ayant aucun acteur sérieux dans les
messageries numériques, les monnaies digitales, les centres de données
et les matériaux critiques, sans compter leur vieille dépendance aux
énergies fossiles venues d’ailleurs. Aucun de ces pays ne veut dépendre
d’autres pour se nourrir. Beaucoup de ces pays, pour d’autres raisons,
souhaitent réduire leur dépendance à l’égard des travailleurs étrangers,
sans qui, pourtant, la plupart des tâches essentielles, invisibles,
sans laquelle aucune société ne pourrait fonctionner, ne seraient pas
remplies. Enfin, dépendance ultime, nous sommes souvent, consciemment
ou non, dépendant de gens que nous laissons mourir pour nous, au travail
ou au combat, sans trop vouloir les voir, parce qu’ils sont loin,
porteurs de notre honte, combattants ukrainiens dans les tranchées du
Donbass ou travailleurs ouïghours dans les ateliers de Shein.
Quel prix serions-nous prêts à payer pour échapper à ces dépendances ?
D’abord, la souveraineté est inflationniste. C’est très évident,
quand elle se manifeste par des droits de douane, qui visent à réduire
l’incitation à acheter des produits étrangers. Tout aussi évident quand
il s’agit de se priver de travailleurs étrangers sur notre sol, ou des
produits fabriqués par des travailleurs étrangers surexploités chez eux.
Tout aussi évident quand il s’agit d’assurer la production des produits
agricoles vitaux. Un peu moins évident quand il s’agit de diversifier
nos sources d’approvisionnement en matériaux critiques, en terres rares,
en composants électroniques, en microprocesseurs, en sources d’énergie
fossile. Moins encore évident, mais tout aussi réel quand il s’agit
d’investir pour se doter de ressources et d’usines sur le sol national
recyclant des matériaux déjà utilisés, ou développant des sources
nouvelles d’énergie, ou des installations de raffinage de matériaux très
largement disponibles à l’état brut, mais raffinés pour l’essentiel
aujourd’hui en Chine. Déjà, aux Etats-Unis, l’inflation revient, en
raison de cette obsession antichinoise, principale menace à la
souveraineté américaine, et en raison d’une politique anti-immigré
faisant apparaitre la dépendance totale de l’économie américaine aux 31
millions de travailleurs nés à l’étranger, dont près de la moitié sont
encore en situation irrégulière et dont dépendent toutes les industries
et tous les services américains. On peut donc s’attendre à ce que la
question de l’inflation, c’est-à-dire du pouvoir d’achat pèse plus que
jamais dans les prochaines échéances électorales aux États-Unis et, dans
une moindre mesure, en Europe.
Ensuite, la souveraineté est fiscalement coûteuse : pour être
souverain, il faut se lancer dans des investissements très lourds, que
le secteur privé ne trouvera pas toujours utile d’initier. Il faudra en
particulier que le secteur public insiste pour que se développent des
centrales nucléaires, mobiles, grandes ou très grandes, qu’il fasse ce
qu’il faut pour aider les entreprises privées à automatiser les
productions qu’elles ne pourront plus sous-traiter à des travailleurs
étrangers. Plus généralement, il faudra que l’État intervienne plus
activement par des réglementations pour inciter à consommer des produits
locaux et pour imposer aux productions étrangères des barrières,
tarifaires ou non. La souveraineté supposera des impôts supplémentaires
ou des choix budgétaires exigeants.
Ensuite la souveraineté est géopolitiquement contraignante. Elle
oblige à diversifier ses alliances, à multiplier ses sources
d’approvisionnement, à prendre garde à ses ennemis, même parmi ses
alliés.
Enfin, la recherche de souveraineté est militairement exigeante :
Pour être réellement souverain, il faut que ses armements soient
produits nationalement, ou au moins par des alliés fiables, ne pas
dépendre d’eux, ou au moins pas d’un seul, pour les renouveler, pour
disposer de pièces de rechange, et pour en avoir un droit d’usage plein
et entier. Plus encore, il n’y a pas de véritable souveraineté sans
préparation au combat. En clair, on ne peut pas être souverain,
ultimement, si on n’est pas prêt à mourir pour la liberté de ses
enfants. Qui y est prêt, aux États-Unis, où plus grand monde veut
accepter d’engager des troupes sur les théâtres extérieurs d’opération
? En Europe, où l’idée de mourir pour Kiev ou Vilnius n’enthousiasme
personne ? Sauf en Chine, ou le patriotisme semble encore indiscuté ?
Oui, la liberté a un coût. Mais elle rapporte aussi un bénéfice :
Sur le terrain économique, ce sont les nations ayant les premières pris
conscience d’un risque de manque et ayant eu la force d’y répondre qui
ont développé les technologies de remplacement de ces manques : Les
Provinces-Unies, avec l’industrie des colorants, quand elles étaient
trop dépendantes des céréales. La Grande-Bretagne avec l’industrie du
charbon fossile, quand les sources d’énergie antérieures se sont
taries. Plus largement, la lutte contre les raretés, et la recherche de
la souveraineté ont été à la source de la plupart des innovations
majeures et des alliances des deux derniers millénaires ; elle peut
encore, aujourd’hui, conduire, en Europe, à un sursaut scientifique et
technologique et au rassemblement de nations comprenant que leur
souveraineté passe par un altruisme rationnel à l’égard de leurs
alliés.
Mal pensée, la recherche de souveraineté conduira à la récession, à
l’inflation, à la xénophobie, à la dictature et à la guerre, comme cela
s’annonce dans toutes les tentatives national-populistes qu’on voit
fleurir aujourd’hui aux États-Unis, en Europe et en Asie.
Bien pensée, la volonté d’être souverain peut être l’occasion de
rapprochements entre voisins pour penser ensemble un monde plus
dynamique, plus juste, plus innovant, plus durable, et plus pacifique.
Jacques Attali
Jacques Attali est docteur en économie, polytechnicien et conseiller
d’État. Conseiller spécial du Président de la République François
Mitterrand pendant 10 ans, il est le fondateur de 4 institutions
internationales : Action contre la faim, Eureka, BERD, Positive Planet.
Jacques Attali est l’auteur de 86 livres (dont plus de 30 consacrés à
l’analyse de l’avenir), vendus à 10 millions d’exemplaires et traduits
en 22 langues. Il est éditorialiste pour les quotidiens économiques Les Échos et Nikkei après l’avoir été pour L’Express.
Il dirige régulièrement des orchestres à travers le monde.
https://www.attali.com/economie-positive/sommes-nous-prets-a-payer-le-prix-de-la-souverainete/