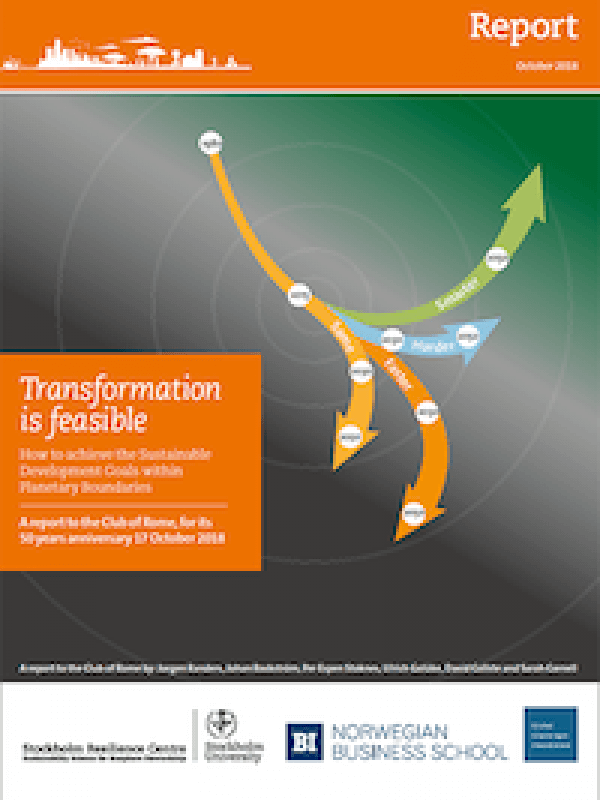Notre dette est plus préoccupante que jamais. La classe politique, de LFI au RN, n’a qu’un mot à la bouche : « augmenter les impôts ».
La nouvelle mode ? La taxe Zucman ! La mesure est désastreuse, le remède serait pire que le mal. Il est temps de le prouver.
La taxe Zucman : beaucoup de bruit, très peu de recettes.
Quelle est l’idée de Gabriel Zucman, cet économiste très à gauche, qui signe des tribunes de soutien à la NUPES de Mélenchon et que l’on voit partout sur les antennes du service public ? Taxer chaque année 2% des patrimoines de plus de 100 millions d’euros. Il prétend que cela rapportera 20 milliards d’euros par an à l’Etat. Même si son chiffre était correct, notre déficit annuel est de 170 milliards d’euros, donc sa taxe ne résoudrait pas le problème.
Mais surtout, ce chiffre est très LARGEMENT EXAGÉRÉ.
D’après Philippe Aghion et 6 autres économistes (Le Monde, 9/09/25), les recettes de cet impôt atteindraient péniblement… 5 milliards d’euros, soit 3 fois moins que ce que nous dépensons chaque année dans l’aide au développement ! Pour leur chiffrage, ces économistes s'appuient sur l'étude de Jakobsen (2024), qui montre que pour chaque euro d’impôt supplémentaire, l’adaptation des comportements aboutit à une perte de recettes fiscales de 74 centimes. Bref, la réalité se venge. Les contribuables s’adaptent. Les entrepreneurs lèvent le pied : pourquoi faire des efforts dont les fruits vous seront presque tous confisqués ? Les contribuables se lancent dans une optimisation fiscale qui nous coûte cher, quand ils ne partent pas tout simplement vivre et travailler à l’étranger.
Retenez, en règle générale, que trop d'impôt tue l’impôt : à partir d’un certain taux, plus on augmente les impôts plus les recettes fiscales baissent. C’est la courbe de Laffer.
M. Zucman l’avoue lui-même : cette taxe a un objectif idéologique, bien plus qu’économique.
M. Zucman le dit noir sur blanc dans son livre : “détruire une partie de l’assiette fiscale peut être l’intérêt de la collectivité”. Traduction : sa taxe n'a pas réellement vocation à rapporter de l'argent à l'Etat, mais uniquement à punir les riches.
On s’étonnait, en effet, de voir la gauche la plus radicale, qui ne s’est jamais préoccupée de nos finances publiques, réclamer aujourd’hui une taxe au nom de la réduction des déficits. On apprend donc, quand on creuse un peu, que ce qui l’obsède, ce n’est pas le peu de recettes qu’une nouvelle taxe engendrera, mais le fait d’assouvir ses pulsions idéologiques.
Taxer les riches, on le fait déjà et cela n’a jamais permis de réduire la dette.
Depuis 2011 nous avons eu :
- la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus,
- puis l’impôt sur la fortune immobilière,
- puis la taxe à 75%, finalement ramenée à 50%,
- ou encore la taxe sur les yachts la contribution différentielle sur les hauts revenus,
- et la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.
Est-ce que cela a réduit les déficits ? Non, ils se sont creusés. Est-ce que cela a réduit le fardeau fiscal de la classe moyenne ? Non, il s’est alourdi.
On a observé les mêmes échecs au Royaume-Uni ou en Norvège, où taxer les riches n’a rien donné de bon. Après tout, c’est logique. Même si on poussait la folie spoliatrice de la gauche jusqu’au bout, on ne réduirait pas notre dette. Regardez : la fortune de Bernard Arnault est estimée à 150 milliards d'euros. Admettons qu'il soit possible de tout lui confisquer. Cela ne permettrait même pas d'absorber notre déficit public de l’année (170 milliards d’euros).
Et l'année d’après ? Nous aurons toujours 3 300 milliards d’euros de dette et toujours 170 milliards de déficit. Sauf que cette fois, il n’y aura plus le groupe LVMH et ses 4 milliards d’euros de recettes fiscales annuelles, ses 40 000 emplois directs et ses 200 000 emplois indirects en France. On s’attaquera alors aux fortunes suivantes : Vincent Bolloré, François Pinault, Xavier Niel. Même pas de quoi financer un seul trimestre de notre déficit abyssal... Avec de telles méthodes spoliatrices, ils seront même sans doute déjà partis. Et après ? La folie s’abattra sur nous tous, avec les mêmes résultats catastrophiques.

La taxe Zucman, c’est donc très peu de recettes, mais beaucoup de dégâts !
Revenons au mécanisme de cette taxe. On pourrait se dire : ce n’est rien, c’est seulement 2% à payer, pour des gens qui possèdent des milliards ! Mais concrètement, cela signifie qu’on demande à un Bernard Arnault (on l’a dit, environ 150 milliards de patrimoine, en comptant ses biens et ses sociétés) de donner 3 milliards d’euros de plus par an au fisc. Évidemment, il ne les a pas sur son compte en banque, ce serait absurde. Il a donc un problème de liquidités… Comment faire pour payer cash 3 milliards chaque année ?
Va-t-il vendre ses biens personnels tous les ans ? Courage pour atteindre les 3 milliards ! Et une fois qu’il aura vendu tous ses biens, devra-t-il vendre ses sociétés pour s’acquitter de ses obligations fiscales ? Des parts de Dior et de Louis Vuitton pour donner de l’argent au fisc ? N’oublions pas que s'il vend des titres pour payer cette taxe, il doit aussi payer de l'impôt sur cette vente : 30% de flat tax, 4% de CEHR. Pour disposer de 3 milliards d'euros pour la taxe Zucman, il doit donc vendre 4,5 milliards d'euros d'actions.
Et ainsi tous les ans, retrouver des liquidités pour payer 2 % de son patrimoine ? Résultat : en 10 ans, il cède environ 30 % de son patrimoine, juste pour payer l’impôt. En 23 ans, il a cédé la moitié de son patrimoine actuel au fisc.
Il ne s’agit pas de le plaindre mais de se demander si c’est bien dans l’intérêt de la France. La réponse est non.
Détails:
La taxe Zucman, ou comment faire passer nos plus belles entreprises sous pavillon étranger.
Et à qui nos hauts patrimoines vont-ils vendre leurs parts ? Les brader à l’étranger pour trouver les liquidités nécessaires à la bonne idée de M. Zucman ? Donc voir disparaître nos fleurons dans les mains d’investisseurs étrangers ?
Prenez Mistral IA : ce fleuron français de l’IA est valorisé 12 milliards d’euros cette semaine. Ses fondateurs devraient payer 240 millions d’impôts avec la taxe Zucman cette année, alors même que l’entreprise ne fait actuellement aucun bénéfice. Les fondateurs de Mistral AI seraient contraints de vendre leurs titres, sans doute immédiatement rachetés par des fonds asiatiques ou américains. Apple est déjà intéressé. Les concurrents de nos entreprises pourraient, une fois de plus, remercier nos brillantes élites de leur livrer nos fleurons sur un plateau.
La taxe Zucman, ou comment dissuader l’innovation en France pour les entreprises les plus prometteuses.
Notez d’ailleurs que si vous taxez une entreprise sur sa valorisation, avant même qu’elle ne fasse le moindre bénéfice, vous êtes certains de tuer l’innovation chez vous. Amazon a mis 9 ans à dégager des bénéfices, Uber 14 ans, Tesla 17 ans. Avec la taxe Zucman, leurs fondateurs auraient dû payer des millions d’impôts de plus chaque année sur des valorisations virtuelles.
D’ailleurs, pour répondre à ce contre-argument de poids, Éric Coquerel, grand promoteur de la taxe, s’est ridiculisé en affirmant que Mistral « ne paierait pas » puisqu’elle ne « fait pas encore de profits ». Il nous prouve par-là que même les défenseurs de la taxe Zucman (et même quand ils sont Présidents de la Commission des Finances !) ne comprennent pas ce qu’ils proposent, car cette taxe porte sur la valeur du patrimoine, pas sur les bénéfices.
De la mauvaise solution à la pire idée : la nationalisation !
L’économiste Thomas Piketty est venu en renfort de Zucman (qui fut son élève !) : il propose que le chef d’entreprise puisse vendre ses titres directement à l’État, au lieu de les vendre à l’étranger ou sur le marché. Brillante idée ! Nationaliser nos entreprises !
Et avec quel argent l’Etat achètera ? On croyait que le but de cette taxe était de renflouer les caisses, pas de les vider. Et même si l’Etat avait les moyens de racheter toutes ces entreprises ? Cette collectivisation serait une catastrophe, comme à chaque fois que l’Etat essaye de jouer aux entrepreneurs.
La taxe Zucman, ou comment pousser les entrepreneurs à l’exil et faire porter le fardeau fiscal sur la classe moyenne et sur nous tous.
Bref, vous l’avez compris au regard des effets désastreux de cette taxe, évidemment que ces hauts patrimoines ne resteront pas en France, l’un des seuls pays du monde qui ne veut pas d’eux, et qui les conduit à dilapider tout ce qu’ils possèdent.
Nos entrepreneurs seraient accueillis à bras ouverts comme une bénédiction pour les comptes publics de n’importe quel autre pays. Ce sera une perte de plus pour nous, car quand un milliardaire s’en va, la gauche sort le champagne, mais c’est toujours les autres contribuables qui trinquent. Les millions d’euros d’impôts, de cotisations et de TVA qu’il faisait rentrer dans les caisses de l’Etat, qui les paiera à sa place une fois qu’il sera parti ? Nous tous. Car la rapacité de l’Etat viendra ensuite s’abattre sur les autres : le seuil de 100 millions sera abaissé, on passera à ceux qui disposent d’un patrimoine de plus de 10 millions, puis ceux qui possèdent 1 millions, puis 100 000, puis ce sera toute la classe moyenne qui devra payer encore plus, et nous tous.
Si vous êtes sept au restaurant pour payer l’addition, et que le septième s’en va : vous devez payer l’addition à six. Et imaginez si le septième était le plus riche, celui qui allait payer le vin ! Car l’addition, elle, ne bouge pas, et c’est bien le problème.
La dette de la France n’est pas un problème de recettes : c’est un problème de dépenses !
Nous ne manquons pas de recettes : nous sommes déjà les champions du monde en la matière ! 45 % du PIB est prélevé chaque année en impôts, charges et taxes : personne ne fait mieux. Chez nous, nul n’échappe aux prélèvements, ni les salariés, ni les patrons. Et si on estime qu’aujourd’hui, les riches ne payent pas assez d’impôt en comparaison de la classe moyenne, il existe une solution très simple : baisser les impôts de la classe moyenne.
La France souffre plutôt d’un Etat vorace qui prélève sans arrêt pour dépenser sans compter. Pour littéralement détruire notre argent dans des gabegies ! La solution n’est donc pas d’augmenter les impôts mais de baisser les dépenses. Sans compter que notre niveau record d’impôts empêche la croissance. Dans notre situation, aucun nouvel impôt, quel qu’il soit, n’est supportable.
La solution existe : baisser la dépense drastiquement et commencer dès cette année par un plan d’urgence. Le voici ci-dessus.
Malgré tout ce que je viens de vous décrire, à l’Assemblée nationale, la gauche a voté POUR cette catastrophe. Les LR étaient ABSENTS. Le RN s’est ABSTENU. Ils avaient seulement 28 députés présents le jour de ce vote majeur !
S’ils avaient tous été présents et voté contre, ils auraient pu empêcher l’adoption de cette folie. C’est ce que nous sommes en droit d’attendre d’une opposition.
Ne faites plus confiance à tous ces partis qui tentent de vous imposer plus de taxes et se soumettent à la gauche. Ils détruiraient notre économie.
Pour résumer : tout comprendre à l’arnaque Zucman.
La taxe Zucman rapporterait très peu de recettes, de l’ordre de 5 milliards d’euros par an. Soit plus de 12 fois moins que mon plan d’économies d’urgence.
En revanche, cette taxe conduirait à un exil massif des entrepreneurs. Le fardeau fiscal finirait donc par peser encore plus lourd sur la classe moyenne, et finalement sur nous tous.
Cette taxe aurait aussi pour effet de faire passer nos entreprises dans les mains d'investisseurs étrangers, et, à terme, de dissuader totalement l’innovation en France.
Pourtant, le problème de la France n’est pas un problème de recettes (nous avons le taux de recettes fiscales / PIB le plus élevé du monde), mais un problème de dépenses. La solution n’est donc absolument pas d’augmenter encore les impôts, mais de baisser enfin les dépenses.
Conclusion : la seule solution pour résoudre le problème de la dette et relancer la croissance : baisser drastiquement la dépense publique, pour baisser massivement les impôts de tous les Français. Nous sommes les seuls à le vouloir et à dire comment nous ferons.
https://x.com/knafo_sarah/status/1968314179896709421
À lire : https://universite-liberte.blogspot.com/2025/09/laffaire-taxe-du-socialiste-zucman.html